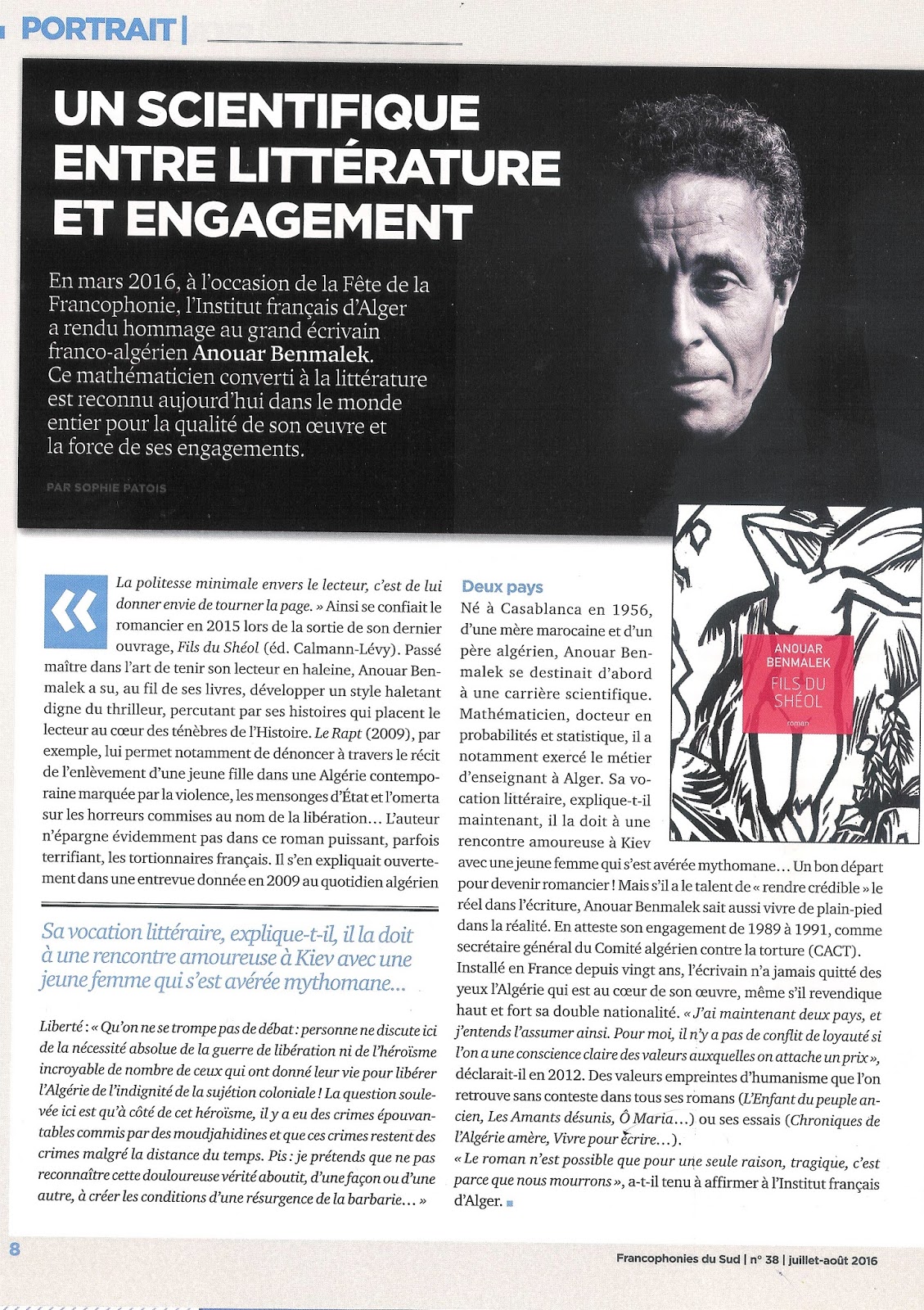écrivain, website: http://anouarbenmalek.free.fr
lundi 3 octobre 2016
mardi 28 juin 2016
De la Shoah au génocide des Héréros, en passant par Daech, l’Arabie saoudite et l’Algérie (El Watan, 26 Juin 2016)
Conférence donnée au Claremont College (Californie, USA, avril 2016) et à la Rencontre Euro-Maghrébine de littérature en Tunisie (mai 2016)
Parce
qu’il y a un écrivain d’une part, parce qu’il y a un lecteur d’autre part, la
littérature est, par définition même, une
tentative de dialogue, vaine plus souvent qu’à son tour, désespérée parfois. Elle
est dialogue avec nous-mêmes bien sûr ; avec également ceux que nous concevons comme les « autres » ;
et, en combinant les deux, avec ces « autres nous-mêmes » que nous
faisons mine d’ignorer, ainsi que c’est le cas dans le monde arabe, ces
identités diverses pourtant elles aussi composantes essentielles de notre être
au monde, mais dissimulées, mais réduites au silence, mais encagées par la
force du « nous-mêmes » officiel.
Dans
mon propos sur l’enchaînement d’événements « para-littéraires » m’ayant
conduit à l’écriture de Fils du Shéol,
des mots reviendront à plusieurs reprises : arabe, écrivain, censure, terrorisme,
Shoah, génocide, Namibie, Hereros…
Commençons
par le mot « arabe », si chargé politiquement à présent qu’il
équivaut presque à une insulte dans la bouche de certains. Décrivons, par
quelques exemples personnels, ce que peut signifier parfois le fait d’être ce
qu’on appelle un « écrivain arabe » ou, plus exactement, un écrivain
issu d’un monde en réalité protéiforme, mais qu’une certaine pensée simpliste
caricature violemment en le réduisant à une seule « ethnie », à une seule
« langue », à une seule « religion ». Or quoi de plus
profondément divers que cette région de la planète qui va de l’océan Atlantique
à l’océan Indien et autres mers et golfes chauds (dans tous les sens du
terme : climatique et politique) ? Prenez les religions, par exemple,
qui sont parfois si exclusives qu’elles servent de définition à des « ethnies ».
Vous avez certes l’islam, religion de la majeure partie des habitants de ce
monde, mais déjà lui-même divisé en versions chiites (avec deux
sous-catégories : septicémain et duodécimain) et sunnites (avec ses quatre
grandes interprétations juridiques). Le mot « divisé » est ici un
euphémisme, tant les différences culturelles et cultuelles sont importantes
entre ces deux visions de l’islam et se traduisent, dans les moments de tension
politique, par des confrontations militaires meurtrières.
Mais
les religions, dans le monde prétendument unifié rigidement par l’islam, ne se
limitent pas, loin de là, à cet islam. Tout le monde a en tête, bien sûr, les Coptes
d’Égypte ou les Juifs de Tunisie, du Maroc et d’autres pays de la région. Avec
un peu d’effort, on peut se souvenir des Druzes qui croient en la réincarnation
et dont la religion, complexe, inclut même des éléments pythagoriciens. Mais
qui sait qu’en Irak, particulièrement le long des cours inférieurs du Tigre
et de l’Euphrate
et près du Chatt-el-Arab, se trouvent encore des croyants d’une
des plus anciennes et mystérieuses religions du monde, celle des Mandéens qui
croient à un ciel appelé Monde de Lumière,
professent l’existence d’un esprit du mal, féminin, appelé Ruha et assurent que
les bébés morts avant d’être baptisés dans l’eau seront portés pour l’éternité
par des arbres portant des fruits ressemblant aux seins de leurs mères ?
Qui avait entendu parler des Yézidis du mont Sinjar avant les massacres
génocidaires commis contre eux par les bourreaux de Daech ? Pour eux, un
Dieu unique a créé le monde, mais n’en est pas le conservateur, cette tâche ayant
été déléguée aux sept anges dont le plus important, Malek Taous, l’ange-Paon,
est à la fois une émanation et un serviteur du Tout-Puissant.
Un
dernier exemple est celui, à peine croyable, des Samaritains— oui, ceux de la
Bible ! Ils appartiennent à l’une des populations les plus petites du monde
(environ 700 individus, partagés à parts égales entre la Cisjordanie et Israël)
mais dotée d’une des plus anciennes histoires écrites attestées : bien que
leur religion soit fondée sur le Pentateuque, ils ne se donnent pas le nom de
Juifs, mais celui d’Hébreux, vénèrent le Mont Gerizim à la place du Mont Sinaï
et considèrent le Temple Juif de Jérusalem comme une innovation impie du roi
David !
Remarquons
que je me contente de ne parler que du monde dit arabo-musulman. Je ne citerai
pas, pour aller plus vite, les religions autres que musulmanes de l’Iran
puisque celui-ci n’est pas arabe (contrairement à ce que beaucoup croient). Il
faudrait alors citer, entre autres cultes, les Zoroastriens dont il reste moins
d’une centaine de familles en Iran, sur un total de cent milles croyants de par
le monde…
La
même diversité, peut-être plus importante encore, existe pour les langues. Allez
dire à un Kurde de Syrie, un Berbère d’Algérie ou du Maroc, un Arménien d’Irak,
un Turcophone de Syrie, que leur langue nationale est l’arabe ! Pire, même
en ce qui concerne l’arabe, il faut distinguer l’arabe dit classique (celui,
disons, des journaux) et ses versions dialectales qui sont si différentes
parfois que deux locuteurs situés chacun aux extrémités de ce monde arabe
auront beaucoup de mal à se comprendre s’ils ne s’expriment que dans les
versions dialectales propres à leurs pays.
L’unicité
tant vantée des croyances et de la langue de ce monde arabo-musulman n’est donc
qu’un mythe ou plutôt un fantasme bien utile pour les pouvoirs de toutes
obédiences qui voudraient imposer un même moule de pensée politico-religieux à
des centaines de millions de personnes ! Mais cette situation de diversité
de facto n’est-elle pas, en réalité,
une situation tout à fait normale et prévisible si l’on considère l’immensité
de la région dont nous discutons ? Imaginerait-on, en effet, une langue
unique utilisée par tous les Européens, fussent-ils Espagnols, Suédois ou
Allemands ?
Mais
il y un domaine où, malgré tout, cette unicité existe : c’est celle de la
façon dont les différents régimes politiques traitent leurs populations
respectives. Tous les types de régimes existent dans cette partie du
monde : monarchies, républiques, émirats, mélanges audacieux et incestueux
des systèmes précédents, tels que les républiques monarchiques de facto. Ajoutons, pour l’exotisme, le
cas algérien où le devant officiel de la scène politique est occupé par un
président le plus souvent en salle de soins intensifs, tandis qu’un cabinet
noir exerce la réalité du pouvoir… Cette diversité de façade des pouvoirs
n’empêche pas que tous ces pays (tous !) agissent semblablement avec leurs
peuples : mépris, répression, censure des médias, intolérance extrême,
militarisation de la société, répression policière, prédation des biens
publics, corruption à tous les niveaux, élections truquées (quand il y en a),
etc.
Reconnaissons
cependant que certains pays arabes réussissent mieux que d’autres dans l’art de
faire oublier leurs turpitudes : l’Arabie saoudite (un Daech qui a réussi) et
le Qatar (un État coffre-fort corrupteur et fournisseur de moyens financiers
aux groupes islamistes radicaux) ont plus d’alliés occidentaux que la Syrie du
dictateur Bachar El Assad, fils de son père, le maître dictateur de fer et de
sang, Hafed El Assad…
Comment
donc se débrouille un simple citoyen, s’il prétend quand même faire œuvre
d’écrivain dans ces conditions ? Eh bien, il aura d’abord à faire
connaissance avec cette institution consubstantielle de toutes les dictatures
et sociétés arabes, la censure, qu’elle soit d’ordre politique, religieuse ou
sociale. La liberté de l’écrivain et de l’artiste en général y reste tributaire
d’un axiome que les pouvoirs politico-religieux résument ainsi : « Je
ne suis disposé à t’accorder la liberté d’expression que si tu prends
l’engagement, sous peine des conséquences les plus redoutables, d’être toujours
d’accord avec moi ! »
Mon
premier exemple est presque amusant quand j’y repense. Je revenais de Kiev
(Ukraine) où j’avais soutenu une thèse de doctorat en mathématiques et j’avais
réussi rapidement à publier en Algérie un premier roman, « Ludmila »,
chez une maison d’édition gouvernementale, roman qui racontait les tribulations
d’un étudiant étranger portant un regard critique sur la société soviétique.
L’URSS existait encore et était dirigée par un certain Gorbatchev. Quelques
jours après sa parution en Algérie, le livre était retiré de toutes les librairies
du pays, à la suite de fortes pressions de l’ambassade d’URSS à Alger. Le
propre directeur de la maison d’édition gouvernementale qui m’avait publié
s’est cru obligé d’écrire ensuite dans la presse algérienne un article de
repentance (à la chinoise) m’accusant d’avoir écrit un livre qui portait
atteinte, selon ses propres mots, aux « intérêts diplomatiques suprêmes de
l’Algérie » ! Vous imaginez : moi, simple étudiant à l’époque…
N’oubliez pas que c’est sa propre maison qui l’avait édité ! Un diplomate
qui était en poste à Moscou à l’époque de la publication du roman à Alger m’a
expliqué récemment que le gouvernement soviétique, partant de l’idée
« raisonnable » que la liberté d’édition n’existait pas en Algérie et
que, par conséquent, toute publication étatique n’y pouvait exister qu’avec
l’aval des autorités algériennes, en avait déduit que mon roman était en
réalité le signal inquiétant d’un imminent éloignement de l’Algérie de ses alliances
géostratégiques traditionnelles…
Ma
deuxième grande surprise en matière de censure a été la censure « socio-islamiste ».
Ce n’est pas vraiment l’adjectif qu’il convient, mais je le garderai faute de
mieux. J’avais publié en France un roman sur les Morisques d’Espagne, ces
musulmans forcés de se convertir à la religion catholique après la chute de
Grenade en 1492. Comme les Marranes, la plupart des Morisques continueront de
croire à leur ancienne foi dans le secret de leurs cœurs, malgré le risque
d’être brûlé vifs si l’Inquisition le découvrait. Au début du 17ème siècle, la
couronne d’Espagne décidera d’expulser tous les descendants de Moriques :
ce sera la première déportation d’État de l’histoire moderne. Le but de mon
livre était, entre autres, de rendre hommage à la tragédie de ces Morisques
oubliés par l’Histoire, encore trop musulmans pour les Chrétiens d’Espagne,
encore trop chrétiens pour les Musulmans d’Afrique du Nord qui, souvent, les
accueillirent mal après leur déportation. Les ennuis de ce livre en Algérie commencèrent
avec les employés de la maison d’édition locale qui devait publier la version
algérienne d’Ô Maria : ceux-ci
menacèrent de démissionner en bloc si leur maison d’édition honorait le contrat
signé et maintenait la publication de mon livre. Puis certains employés encore
plus zélés envoyèrent le fichier du roman à la presse en soulignant ce qui leur
apparaissait comme blasphématoire…
Cette
époque de ma vie qui a suivi la publication d’Ô Maria a été très difficile à vivre. Après une campagne de
dénonciations haineuses de mon livre en Algérie, reprise comme une trainée de
poudre partout dans le monde arabe par des journalistes n’ayant pas lu une
ligne de mon livre (et pour cause, celui-ci n’ayant pas été traduit en arabe),
une condamnation à mort avait été lancée à mon encontre par un groupe terroriste.
Sur les conseils des services de sécurité français, ma famille et moi avons dû
quitter le domicile familial (Notons au passage qu’il a fallu expliquer à mon
jeune fils pourquoi nous quittions la maison : des problèmes de plomberie,
ce qui l’avait ravi puisque cela voulait dire ne plus aller à l’école pendant
quelques jours…).
Ah,
vous vous retrouvez bien seuls en pareille circonstance… comme tant d’autres
intellectuels à travers le monde arabe. Mais bon, tout cela est d’une terrible
et féroce banalité dans cette région du monde dominée par l’idéologie et la peur
des fanatiques de tout poil : vous pouvez être condamné à mille coups de
fouets pour avoir osé émettre une opinion modérée sur l’égalité des religions ;
vous pouvez être décapité sur la place publique, au choix, par un État membre
de l’ONU parce que vous êtes un opposant politique, ou par un groupe terroriste
parce que vous dirigez un département d’antiquités romaines ; vous pouvez
être fusillé parce que vous n’avez pas répondu correctement à une banale
question de théologie à un barrage routier ; vous pouvez être égorgés en
groupe parce que vous appartenez à une autre religion ; vous pouvez être
vendue comme esclave enfant à des combattants qui prendront d’abord la
précaution de prier dévotement avant de vous violer, etc.
Tout
cela sans provoquer d’indignations massives, sans que des foules scandalisées
ne sortent dans les rues de toutes les villes arabes pour clamer : pas en
notre nom !
Alors,
pour les écrivains de cette région, il ne reste plus qu’une seule issue
honorable : celle de s’obstiner à écrire puisque tout leur serait
dorénavant interdit. Mais signalons au passage qu’il y a aussi, pour moi et
pour beaucoup d’autres personnes issues de cette région du monde qui va de
l’Atlantique au Golfe persique, des raisons d’espérer importantes dans ce monde
d’obscurité. N’oublions pas, et ce n’est pas contradictoire avec ce que j’ai
déjà dit, n’oublions jamais ces multitudes d’individus dans ce monde arabe qui
persistent, au prix de leurs vies, à résister courageusement à l’oppression
tant des régimes corrompus que des milices terroristes, alors que tout devrait
les inciter à l’abandon et au désespoir le plus absolu.
Nous
devons lire les poètes et les romanciers libres de ce monde arabe qui risquent
littéralement leurs vies pour un mot de travers. Nous ne soutenons pas assez
ces écrivains, ces journalistes ou ces blogueurs condamnés au fouet et à de
longues années de prison par des régimes théocratiques. Nous restons trop
souvent muets face à la puissance de l’argent du Golfe, Arabie saoudite en
tête, et de sa propagande intégriste.
Qu’on
ne se méprenne pas sur mes propos : je parle du monde arabe avec colère
parce que j’aime passionnément ce monde, celui de mon père et de ma mère et des
années les plus importantes de ma vie, celles qui vous forment au plus profond
de vous-même. Une tristesse infinie me prend quand je réalise l’état de
destruction, de chaos et de haine du monde arabe actuel. L’Irak, diverse dans
ses croyances et ses cultures, héritière de la brillante civilisation des
Abbassides, a peut-être fini d’exister. Entre terrorisme abject et cruelle
dictature, la grande Syrie avec ses centaines de milliers de morts est en voie
de balkanisation définitive. Que dire alors du petit Yémen, écrasé par
l’affrontement entre les armées d’une coalition brutalement menée par l’Arabie
saoudite et des Houthis au service de l’Iran ? L’intolérance absolue
introduite par les mouvements terroristes à vision messianique du type de Daech
tente d’ensauvager de manière uniforme une région dont la caractéristique
capitale (et souvent dissimulée) a été d’abord, comme j’ai essayé de le
montrer, la pluralité culturelle, langagière, ethnique et religieuse.
Venons
maintenant à ce qui fait l’objet du cœur de ce texte : Fils du Shéol. La presse occidentale et
arabe a dit de cet ouvrage que c’était le premier roman « arabe » sur
la Shoah, en omettant systématiquement (cela est significatif aussi d’un certain
racisme inconscient) de noter que Fils du
Shéol se veut aussi le premier ouvrage de fiction (et pas seulement au
niveau du monde arabe) à traiter d’un autre génocide, totalement méconnu, celui
des Hereros.
J’ai
toujours été passionné par ce type de littérature décrivant la confrontation
terrible, parfois mortelle, toujours révélatrice, qui met aux prises des
personnages « ordinaires » avec la grande broyeuse de l’Histoire.
Dans mes romans, j’ai débuté évidemment par ce que je connaissais le mieux,
l’Algérie, sa guerre d’indépendance, le vol de la démocratie par le pouvoir
militaire, suivi par la terreur islamiste et ses deux cents milles morts ;
puis de fil en aiguille, le Moyen-Orient avec ses interminables et désespérants
conflits, l’Andalousie et la déportation des Morisques. Je suis même allé en
Tasmanie pour évoquer le génocide « réussi » des Aborigènes de cette
île australienne à la fin du 19ème siècle.
Dans
mes romans, je me rends compte au fond que j’ai essayé sans relâche, plus ou
moins consciemment, de répondre à l’interrogation qui nous taraude tous à
certains moments : « Qu’aurais-je fait si… ? Que ferais-je
si… ?»
Qu’aurais-je
fait, par exemple, si j’avais été torturé pendant la guerre d’Algérie par
l’armée française dans les années cinquante… ou par l’armée algérienne dans les
années quatre-vingts ? Qu’aurais fait si j’étais tombé entre les mains
d’un groupe terroriste algérien ? Qu’aurais-je fait si j’avais été le
dernier aborigène de Tasmanie à la suite des massacres perpétrés par les colons
anglo-saxons, etc. ?
À
chacune de ces interrogations, j’ai tenté de répondre par un roman.
La
question, qui allait mener à Fils du
Shéol, s’est finalement imposée à moi avec une telle force que j’ai décidé
de tenter d’y répondre, dans la mesure de mes moyens, et au moins
partiellement : « Qu’aurais-je fait si j’avais été un Allemand juif,
pris, ainsi que toute ma famille, dans les mâchoires de l’appareil nazi, en
route vers les chambres à gaz ou, pire, destiné à devenir un esclave membre des
Sonderkommandos, condamné à enfourner
ses propres coreligionnaires dans les fours crématoires, avant d’y être
précipité à son tour ? »
J’avais
déjà lu et vu un nombre important de livres et de films sur la Shoah, j’en ai
encore lu et vu des dizaines au cours de l’écriture de ce livre pour finalement
m’en tenir à une unique ligne de conduite : raconter le seul point de vue
d’une famille « ordinaire » de Juifs berlinois, ni plus ni moins
héroïques que d’autres et n’ayant pas plus d’informations sur la suite des
événements que n’importe quel citoyen banal du Troisième Reich.
Des
appréhensions, j’en ai eu mon lot, bien sûr, mais ce n’était pas parce que
j’étais probablement le premier « Arabe » ou plutôt « Arabo-Berbère »
à consacrer un ouvrage de fiction à la Shoah. Ma crainte, constante, avait été
de ne pas être à la hauteur d’un sujet sur lequel règne cette malédiction
d’être « indicible ». Je récuse de toutes mes forces cette
qualification d’ « indicibilité », de
« sacralisation » de la Shoah, au point qu’il serait presque
blasphématoire de s’en emparer par les moyens de la fiction : le génocide
des Juifs et des Tziganes a été commis par des êtres humains sur des êtres
humains, et, de ce simple fait, il peut et doit être raconté avec les mots des
humains, aussi difficile que cela puisse être.
Le
seul frein qui m’avait longtemps retenu d’écrire ce roman sur la Shoah a été un
problème de « légitimité ». Non pas la légitimité intrinsèque de
l’écrivain : j’affirme qu’un écrivain a le droit de s’emparer de n’importe
quel sujet, nous faisons tous partie de la même communauté des Homo sapiens et
n’importe quel malheur touchant une partie de cette communauté nous concerne ou
devrait tous nous concerner. Je parle ici plutôt d’une légitimité vis-à-vis de
moi-même : qu’apporterais-je de nouveau, moi Africain, à une histoire qui
s’était produite loin de mon continent d’origine, qui n’avait a priori aucune
relation avec celle de l’Afrique. Le déclic a été la lecture d’une biographie
d’un des dirigeants les plus importants du système nazi, Hermann Göring. Au
détour d’une phrase, j’y ai appris que son père, Heinrich Göring, avait été
gouverneur de la German South West Africa, autrement dit : l’Afrique du
Sud-Ouest Germanique (actuellement la Namibie). Intrigué, j’ai commencé à
étudier l’histoire de cette colonie allemande, dont je ne soupçonnais même pas
l’existence auparavant. J’ai découvert peu à peu l’ampleur des massacres commis
par les soldats du Deuxième Reich pendant leur occupation, qui culmineront en
1905 avec le génocide des Hereros et des Namas. 80% des Hereros y perdront la
vie dans des conditions épouvantables, suivis, peu de temps après, par 50% des
Namas. Ma stupéfaction initiale vient de ce que je n’avais jamais entendu
évoquer précédemment ce génocide inaugural du 20ème siècle. J’ai vérifié autour
de moi, j’ai posé la question à nombre d’écrivains, africains et
européens : partout la même extraordinaire ignorance de ce qui n’aurait
jamais dû être ignoré. On pouvait donc avoir commis le premier génocide du
siècle dernier et le faire disparaître du menu de la mémoire commune !
Des
recherches plus attentives m’ont alors permis de comprendre que le génocide
perpétré dans la GSWA avait été, en quelque sorte, un « brouillon »
artisanal de que l’Allemagne nazi mettrait en œuvre, moins de quarante ans plus
tard, de manière monstrueusement industrielle, contre les Juifs et les
Tsiganes : mêmes obsessions raciales, premières expériences à visées
pseudo génétiques, personnages ayant fait leurs premières armes dans la colonie
et qui se retrouveront en dirigeants de premier plan dans le système hitlérien,
même meurtrière philosophie pénitentiaire avec des camps de concentration (oui,
c’était bien leur dénomination officielle !) où les prisonniers affamés et
obligés de porter des plaques de cuivre numérotées autour du cou, se voyaient exploités
comme main d’œuvre servile jusqu’à leur mort par exténuation…
Et,
pour finir, en miroir à la décision de mettre en branle la « Solution
finale » contre les Juifs prise par les Nazis à la conférence de Wannsee,
le Vernichungsbefehl du général von
Trotha ordonnant, au nom du Kaiser Wilhelm, que « Chaque Herero trouvé à
l’intérieur des frontières allemandes, armé ou non, en possession ou non de
bétail, sera tué »…
À
ce moment, j’ai su que je tenais là ma légitimité personnelle en tant
qu’écrivain « arabe » et, plus généralement « africain » :
la Shoah nous concerne aussi, nous autres Africains, et de manière presque
directe, parce qu’elle a, en quelque sorte, « un peu » commencé en
Namibie.
Signalons
que ce n’est qu’en juillet de l’année dernière que l’Allemagne a reconnu le
génocide des Hereros et des Namas.
Je
voudrais terminer par quelques réflexions sur le métier de romancier. Je crois
que le roman correspond, au fond, à une expérience presque scientifique :
on prend un certain nombre de personnages auxquels on impose des contraintes de
différentes sortes, on les plonge dans des conditions extérieures ne dépendant
pas d’eux (le pays, les événements historiques, les conditions sociales et
politiques, les croyances religieuses) et l’on observe comment chacune de ces
créatures virtuelles, munie de son lot de déterminisme et de libre arbitre, va
se débrouiller pour mener à bien sa barque. Ma description est évidemment
caricaturale, mais l’important est que le romancier possède, au départ, une
liberté de choix s’apparentant à celle du scientifique qui hésite entre plusieurs
hypothèses, envisage plusieurs expériences pour les tester, et qui se doit, à
chaque étape, de rapporter impartialement les résultats de son travail.
À
mon avis, un bon romancier (ou, en tout cas, le genre de romancier que j’aime)
a l’obligation d’une certaine neutralité envers ses personnages. Même s’il lui
arrive d’éprouver de l’affection pour ses personnages de papier, il ne doit pas
oublier de garder également un regard presque cruel de lucidité dans la description
de leurs comportements et de leurs motivations profondes.
Un
être humain n’est pas façonné uniquement par les mâchoires cannibales de l’Histoire
avec un grand H et leur insatiable appétit de sang humain. Un homme ou une
femme peuvent aussi décider de vivre leurs petites destinées à côté de cette
dévoreuse de destins humains, faire semblant de l’ignorer ou, plus exactement,
de souhaiter de toutes leurs forces que cette dernière les ignore. Ils peuvent
vouloir aimer, haïr, jalouser, faire preuve de bonté ou de mesquines et
ordinaires ambitions alors que de grands et épouvantables événements projettent
leurs ombres mortelles sur eux.
Ce
que j’essaie de montrer dans mes romans, c’est cette bataille entre le
déterminisme terrifiant de certains moments historiques et la liberté,
chèrement payée parfois, que possède malgré tout l’être humain de ne pas être
totalement défini par eux. Mes personnages ne sont jamais des héros, mais des
êtres ordinaires révélés à eux-mêmes et aux autres par des conditions extraordinaires.
La
vie est une expérience terrible : nous naissons pour mourir et nous le
savons. Cette seule réalité fait de tout être humain un philosophe
tragique : vous regardez une personne que vous aimez, une femme, un homme,
des enfants et vous savez en toute certitude qu’ils vont mourir, que vous allez
mourir ! Cela est insupportable et transforme toute existence humaine en
un roman indépassable : aucune œuvre littéraire n’atteindra jamais la
grandeur cruelle d’une vie humaine ; à peine commençons-nous à comprendre
la vie qui nous est donnée que nous la perdons. D’une certaine manière, une vie
n’est qu’une longue agonie : le premier cri d’un bébé est celui-là même
qui déclenche le compte à rebours qui le mènera à la tombe.
Toute
écriture est, en ce sens, une œuvre philosophique : tout rire, tout
bonheur, toute exaltation créés par un roman ou un poème sont certes des
victoires contre la mort, mais des victoires tout à fait provisoires, tout à
fait dérisoires contre le seul vainqueur à être toujours présent seul sur le
podium final : la mort. Mais la grandeur de l’être humain, seul animal
doté de la connaissance de sa finitude sur terre, est justement d’accumuler ces
victoires provisoires dans tous les domaines, le domaine de l’art et de la
science en particulier, et de les transmettre à ses congénères, qu’ils soient
actuels ou, surtout, futurs, transformant ainsi son minuscule présent éphémère
en une sorte d’immortalité itérative, transmise par une longue chaîne remontant
à l’apparition de notre espèce.
Au
fond, la littérature n’a de justification que parce que nous mourons. Enlevez
la mort et la littérature devient inutile, sinon ridicule.
Un
écrivain s’octroie le droit d’écrire ce qu’il désire, là où il le désire, à
charge pour lui d’assumer l’honneur ou le déshonneur de ses écrits. Être
écrivain ne donne pas, par ailleurs, la certitude d’avoir raison. Ne pas
l’être, également.
Je
continuerai donc à faire apparaître des mots sur mon écran jusqu’à ce que la
mort, un bon matin ou un mauvais soir, ne me tape sur l’épaule en me
soufflant : « Allez, fiston, ton tour de piste est terminé… »
Un
écrivain algérien, Mouloud Mammeri, a écrit un jour : « Ceux qui,
pour quitter la scène, attendent toujours d’avoir récité la dernière réplique à
mon avis se trompent : il n’y a jamais de dernière réplique – ou alors,
chaque réplique est la dernière, on peut arrêter la noria à peu près à
n’importe quel godet, le bal à n’importe quelle figure de la danse… »
Anouar Benmalek (2016)
jeudi 2 juin 2016
From the Shoah to the Herero Genocide: A Singular Journey for an Arab Writer Anouar Benmalek May 2016 (Text of the talk)
CLAREMONT, California – April, 2016 Anouar Benmalek, an esteemed novelist, journalist, mathematician, and poet, presented at Scripps on the topic “From the Shoah to the Herero Genocide: A Singular Journey from an Arab Writer” for the O’Brien Distinguished Visiting Professor Lecture. Benmalek holds dual Algerian and French citizenship and is a professor of mathematics at the University of Paris-Sud. He has won several of France’s prestigious literary prizes, and has been nominated for the Nobel Prize in Literature. His historical novels examine the lives of ordinary people living in violent times, that is, under conditions of genocide, political repression, racism, and religious fundamentalism.
… Through the “para-literary” life of an Arab writer, I will try to talk about the sequence of events which lead me to “Son of Sheol”. Some words will be used on several occasions: Arab, writer, censure, terrorism, Shoah, genocide, Herero…
Let us start with the word “Arab”, so charged politically now that it is equivalent to almost an insult in the mouth of some people. Let us describe, through personal examples, what it means to be qualified as an “Arab writer” or, more exactly, a writer belonging to a world actually protean, but that a certain ignorance caricatures violently by reducing it to only one “ethnic group”, with only one “language” et one “religion”. In fact, there is nothing that could be more deeply various than this part of our planet, which extends from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean and diverse other hot gulfs and seas (hot in all the meanings of the term: climatic and political)?
Take religions, for instance, which are sometimes so “exclusive” that they are used as a false definition for the supposed “ethnicity” of some groups. There is first Islam certainly, faith of the major part of the inhabitants of this Arabic world, but itself divided into Shiite versions (containing two main subcategories: seven-imams and twelve-imams Shi’ism) and Sunnites ones (with their four great schools of interpretations). The word “divided” is an euphemism here, so much the cultural and worship differences are important between these two visions of the islamic heaven and can be transformed, in periods of political tension, by fatal military confrontations (see Iraq-Iran war…)
But, in this world supposedly unified by Islam, faiths are not limited, far from there, to Islam. Everyone has in mind, of course, the Copts of Egypt or the Jews of Tunisia, Morocco and other countries of the area. With a little effort of memory, one can remember the Druze who believe in reincarnation and whose complex religious system includes even Pythagorean elements. But who knows that in Iraq, particularly along the lower courses of Tiger and Euphrate rivers and close to Chatt-el-Arab, live believers of one of the oldest and mysterious religions of the world, that of Mandaeans, who believe in a Heaven called Light-World, profess the existence of an evil female spirit, called Ruha, and ensure that babies died before being baptized in water will be carried for eternity by trees holding fruits resembling the breasts of their mothers? Who had heard of Yezidis of the Sinjar mount before the genocidal massacres committed against them by the killers of ISIS: for Yezidis, a supreme unique God created the world, but delegated the “maintenance” of His universe to seven angels, the most important being Malek Taous, the angel-Peacock, who is at the same time an emanation and a servant of the Almighty.
A last example is that, hardly believable, of the Samaritans - yes, those of the Bible! - belonging to one of the smallest populations of the world (approximately 700 individuals, divided equally between the Palestinian West Bank and Israel) but possessing one of the oldest attested written histories: although their religion is founded on the Pentateuch, they do not give themselves the name of Jews, but that of Hebrews, venerate the Gerizim Mount in the place of the Sinai Mount and regard the Jewish Temple in Jerusalem as an impious innovation of king David!
Notice that my talk is restricted to the Arab world only. I will not address religions of Iran, for example, since Iran is not an Arab country (contrary to what is often believed). It would be, in this case, necessary to quote, for instance, the Zoroastrians’ religion, with its unique cosmogonic dualism and eschatological monotheism …
Same diversity, perhaps more important, exists for languages: tell a Kurd of Syria, a Berber of Algeria, an Armenian of Iraq, a Turkoman of Syria, that their mother language is Arabic! Worse, even with regard to Arabic langage, it is necessary to distinguish Arabic known as traditional or classical Arabic (that, let us say, the language of newspapers) and its dialectal versions which could be so different that two speakers located each at the ends of this Arab world will have much difficulty to understand each other if both of them uses only local specific vernacular versions of Arabic.
The publicly claimed unicity of beliefs and languages of this “Arab” world is thus only a myth or, more exactly, a useful tool for the different dictatorial authorities of this area to impose the same political and religious mould of thought on hundreds of millions people! To understand how much this official unicity for such a vast area can be only a phantasm, it is enough to apply the same concept for Europe: is-it realistic to imagine a single language for all people of Europe, from Portugal to Poland for instance …?
But there is a field where, despite everything, this unicity exists: it is the way the Arab regimes treat their respective populations. All types of models of government exist in this part of the world: monarchies, republics, emirates, incestuous mixtures of the preceding systems, such as monarchical republics, etc. This apparent diversity does not prevent all these countries (all!) to act similarly with their people: contempt, police repression, censure of the medias, extreme intolerance towards freedom of political and religious expressions others than that permitted by the States, militarization of societies, predation of national wealth, corruption at all levels, fraudulent elections (when there are elections), etc.
Let us recognize, however, that a number of Arab countries know better than others how to make what is named pompously the international community shut their eyes when they commit their crimes: Saudi Arabia (a sort of successful ISIS) and Qatar (a corrupting State provider of financial support to some radical Islamic groups) have more dedicated Western allies (included USA and France) than the less rich Syria of dictator Bashar El Assad…
How thus an ordinary Arab citizen manages to be a writer under such conditions? First, he has to make acquaintance with this consubstantial institution of all Arab societies: censure, whether of political nature, social or religious! The freedom of the writer and the artist in general is symbolized by an axiom which the governing powers summarize as follows: “I agree to grant you freedom of speech and beliefs if and only if you pledge, under penalty of the most frightening consequences, to always agree with me! ”
My first example is almost amusing when I recall it. I returned from Kiev (Ukraine) where I had defended a PhD thesis in mathematics and I had quickly succeeded in publishing in Algeria a first novel “Ludmila” in a state publishing house, novel about the tribulations of a foreign student with a critical eye on the Soviet society. The USSR still existed and was directed by a guy named Gorbatchev. A few days after its publication in Algeria, the book was withdrawn from all the bookstores of the country, following strong pressures from the Soviet embassy. More, the director of the publishing house was compelled to write in the Algerian press a paper of repentance (in pure Maoist style) accusing me to have written a book which, according to his own words, was damaging to the “supreme diplomatic interests of Algeria”! You imagine: me, a simple student damaging such great diplomatic interests! A diplomat who was in post in Moscow at the time of the publication of the novel explained to me, years after, that the Soviet government, on the basis of the “reasonable” idea that freedom of edition did not exist in Algeria, had deduced that the publication of my novel was in fact a warning sign of great changes in the geostrategic alliances of Algeria…
My second great surprise as regards censure was the “social-islamist” censure. This adjective is not really appropriate, but I will keep it for lack of a better term. I had published in France a novel on the Moriscos of Spain, these Moslems obliged to convert by force to the Catholic religion after the fall of Grenade in 1492. Like Jewish Marranos, the majority of Moriscos will continue to be secretly faithful to their original religion, in spite of the risk to be burned alive in case Inquisition discovered it. At the beginning of the 17th century, the crown of Spain expelled all the descendants of Moriscos in the first State deportation in modern history. The goal of my book was, among other things, to pay homage to the tragedy of these Moriscos forgotten by History, considered as too Islamic by the Christians of Spain, and too Christian by the Moslems of North Africa who, too often, badly unwelcomed them after their deportation. The trouble with this book in Algeria started when all the employees of the local publishing house with which the contract was signed threatened to resign if their management decided to maintain the publication of “Ô Maria”. Then some over-zealous employees sent the file of the novel to the newspaper about which I spoke earlier …
This period of my life, following the publication of O Maria, was very difficult because it affected also my family. After a heinous campaign of denunciation Algeria, which spread as a powder trail in Arab newspapers by journalists from Irak, Lebanon, etc., not having read a single line of my book (Ô Maria was available only in French at this time), a terrorist group called for my killing. On the advice of the French security services, we left home (By the way, it was necessary to explain to my young son that we had to leave our house because of plumbing problems. My son was very glad, of course, since it meant for him some unexpected days of holiday …).
Ah, you feel intensely alone in such circumstances… as it is the case unfortunately for too many intellectuals and artists throughout the Arab world. All of this is at the same time terrifying and savagely banal in this area dominated by political and religious fanaticism, whether imposed by states or militant Islamic groups: you can be condemned to a thousand whiplashes because of a moderate tweet on the equality of religions; you can be beheaded on public places by a state, in spite of its UN membership and blabla-human rights obligations, because you are a political opponent, or by a terrorist group because you are in charge of a Roman antiquities department; you can be shot because you did not answer correctly to an odd question of theology at a check-point; you can have your throat cut by astonishingly young terrorists because you belong to another religion; you can be sold as a slave child to combatants who will take first the precaution to pray devoutly to God before raping you, etc.
All that without causing massive indignations all around Arab World, without making scandalized crowds fulling the streets of all Arab cities to protest and to claim: not on our behalf, not on our names!
Then, for writers and free thinkers of this area, there remains only one honorable but hard exit: to keep writing even if the price for freedom of art and speech can be high in this world of darkness. But I decided to remain optimistic, because the contrary would be an insult directed to these numerous isolated individuals who persist, at the price of their lives, to resist courageously to the oppression of their states as well as to the atrocious terror of ISIS groups and Co, despite despair, solitude, lack of solidarity and international hypocrisy.
We must read these free journalists, poets and novelists of this Arab world who literally risk their lives or long years of prison for a word. We do not support enough these courageous men or women. In The West and in the Arab countries, we generally adopt too often a cowardly behavior when faced to the power of oil and money of Saudi Arabia and other Gulf states.
Let me be clear and don’t be mistaken by the bitterness of my statements : I speak about the Arab world with anger because I like this world passionately, it is the world of my father and my mother and the world of the most important years of my life. An infinite sadness takes hold of me when I see the present condition of destruction, chaos and hatred of my beloved world.
Iraq, with all its richness of beliefs and cultures, heir of the brilliant Abbasids’ civilization, has perhaps finished to exist as an unified country. Caught in a stranglehold between contemptible terrorism and cruel dictatorship, the great Syria with its hundreds of thousands of deaths is in the final steps of irreversible balkanization. What, then, to say about Bahrein or Yemen, the last crushed without mercy by the confrontation between a brutal coalition led by Saudi Arabia and Houthi militias at the service of Iran? The absolute intolerance introduced by terrorist movements with messianic vision tries to create a new savage society in place of the old societies whose principal (and generally dissimulated) characteristic was initially, as I tried to show, cultural, linguistic, ethnic and religious plurality.
Let us come now to what is part of the title of this talk: Son of Sheol. The Western and Arab press has said that this novel is the first “Arab” novel on Shoah, while systematically omitting (that is significant also of a unconscious racism) to point out that “Son of Sheol” is also the first work of fiction (and not only in the Arab world) to deal with an another completely ignored mass crime, the first genocide of the 20th century, that is the genocide of Herero people.
As a reader and as a writer, I developed a passion for this type of literature describing crucial confrontations, sometimes even mortal, always revealing, between “ordinary” characters and History (with a big H). In my novels, applying this principle, I begin with what I knew best, Algeria and its fight for independence, the theft of democracy by army at the end of its war of liberation, followed, in the eighties, by Islamic terror and its two hundred thousand victims; then, one thing leading to another, Middle East with its interminable and despairing conflicts, Andalusia and deportation of Moriscos. I even wrote on Tasmania to evoke the “successful” genocide of Aboriginals of this Australian island at the end of the 19th century. In my novels, I realize that I tried essentially, more or less consciously, to answer the same old interrogation: “What would I have done if…? What would I do if…?”
What would I have done, for example, if I had been tortured by French Army during the Algerian war of independence in the Fifties… or by the Algerian army in the Eighties? What would have done if I had fallen between the hands of an Algerian terrorist group? What would I have done if I had been the last of the Aborigines of Tasmania, after the massacres committed by English colonists, etc?
To each of these interrogations, I tried to answer by a novel.
For Son of Sheol, the question was as simple as horrifying: “What would I have done if I had been a Jewish German on his way, with all his family, to the gas chambers, or, worst, condemned to become a slave member of these unimaginable Sonderkommandos, expected to throw his own co-religionists in the flames of ovens, before being thrown there in his turn?”
After a great deal of hesitations, readings and several tries, I decided to stick with a simple policy: to tell the story from the sole point of view of an “ordinary” family of Berliner Jews, neither more nor less heroic than others and not having more information on the near future than any banal citizen of Third Reich.
I had my share of worries and doubts during the more than three years of work on this book, of course, but it was not because I was probably the first “Arab” or rather “Arab-Berber” to write a text of fiction dedicated to Shoah. My constant fear had been to be unable to match the challenge of a theme which is burdened by the supposed curse to be “indescribable”. I refuse absolutely this qualification of “indescribability”, this “sacralization” of Shoah, in a way that it would be almost blasphemous to try to understand it by the tools of fiction: the genocide of the Jews and the Gypsies was a crime committed by human beings on human beings, and, from this simple fact, it can and must be told with the words of human beings, as hard as that may seem.
The only thing which prevents me during a long time to write a novel on Shoah was a problem of “legitimacy”. Not the intrinsic legitimacy of the writer: I affirm that a writer has the right to treat any subject, we all belong to the same community of Homo Sapiens and any calamity affecting part of this community affects all of us or should affect all of us. I speak here rather about legitimacy with respect to myself: what would I bring new, as an African, about this European tragedy which took place far from Africa, which did not seem to have any relation with the history of my continent?
The turning point came with the reading of a biography of one of the most important leaders of the Nazi system, Hermann Göring. In the course of a sentence, I learned that his father, Heinrich Göring, had been governor of what was then called the German South West Africa, in other words: current Namibia. Intrigued, I started to read more on German colonialism in general and on this Namibian colony in particular, about which I did not even suspect the existence before. I discovered little by little the extent of the massacres made by the soldiers of the Second Reich during the German occupation of the GSWA, which culminated in 1904 with the genocide of Hereros and Namas: 80% of Hereros were killed, followed, only months after, by 50% of Namas. My amazement came from the fact that I had never heard about what appears to be the first genocide of the 20th century. I checked around me, I discussed the question with many writers, African and Europeans: all shared my ignorance, the same extraordinary ignorance about what should have never been ignored.
How is it possible that an entire genocide was never - and is not so far - part of our common memory?
More attentive research allowed me to understand that the genocide perpetrated in the GSWA had been, to some extent, an artisanal “draft” of the system Nazi Germany, less than forty years later, in a monstrously industrial way, would implement against Jews and Gypsies: similar racial obsessions, first pseudo-scientific experiments with genetic goals, individuals having served their apprenticeship as massive criminals in the colony and who will become important cogs of the Hitlerian machinery, etc.
I knew then that I found my personal legitimacy as an “Arab” writer and, more generally as an “African” writer: Shoah also concerns us as Africans, and in an almost direct way, because it has, in a certain sense, “started” in Namibia.
It is worth to notice that it is only in July 2015 that Germany recognized officially the Herero and Nama genocide as genocide…
I would like to finish my speech by some reflections on the job of novelist. I believe that the novel corresponds, by many aspects, to a scientific endeavor: one takes a certain number of characters on whom are imposed constraints of various kinds, one plunges them under external conditions not depending on them (country, historical events, social conditions and policies, religious and social beliefs) and one finally observes how each of these virtual creatures, armed with a complex mixture of determinism and free will, will manage to keep one’s ship going in the right direction. My description is obviously a caricature, but the important thing is that the novelist has, at the beginning of his work, a freedom of choice not very different from the scientist’s one who hesitates between several assumptions, looks for the right experiments to test each one, and report impartially, at each stage of his research, the result of his findings.
In my opinion, a good novelist (or, more exactly, the kind of novelist I like) has the obligation to observe a certain neutrality towards his characters. Even if he can feel affection towards his paper characters, he should not forget to keep an almost cruel lucidity in the description of their behaviors and motivations.
A human being is not a pure victim of History. A man or a woman can also decide to live one’s small life, pretending to be unaware of History or, more exactly, wishing with all one's heart that History is unaware of him or her. He or she can decide to love, to hate, to be jealous, to show all kinds of petty and ordinary ambitions even when History begins to project its gigantic and, too often, mortals shades on them.
What I try to show in my novels is this battle between the terrifying determinism of certain historical moments and this small piece of freedom, dearly paid sometimes, that every one of us possesses and can decide to use. My characters are never heroes, but “ordinary” persons, revealed to themselves and to the others by “extraordinary” conditions.
Life is an extreme experience: we are born to die and we know about it. This reality transforms any human being in a tragic philosopher: you look at a person whom you love, a woman, a man, children and you know with absolute certainty that they will die, that you will die! That is unbearable and transforms any human existence into an unsurpassable novel: no literary work will ever reach the cruel tragedy of any man or woman’s life. No sooner have we started to understand the life given to us than we lose it. In a certain manner, a life is only one long death agony: the first cry of a newborn baby is the one which starts the countdown leading him to the tomb.
Any writing is, in this sense, a philosophical work: any laughter, any happiness, any exaltation created by a novel or a poem are victories against death, but of a completely temporary type, totally ridiculous against the only winner always present, and alone, on the final podium: death. But the greatness of this weird animal, Homo Sapiens, is precisely to accumulate these temporary victories in every field possible, art and science in particular, and to transmit them to his fellow human beings, thus transforming his tiny transitory present into a kind of iterative immortality going up to the appearance of our species.
It seems that this curious activity, literature, has a justification only because we die. Remove death, and literature becomes useless, if not ridiculous. In my opinion, it is the presence of Nothingness around our short presence on earth that explains this “humanity's strange, ardent love affair” with literature.
Thank you for your attention.
« L’automne du patriarche » du système algérien : que cesse cette mascarade !
Ce titre s’inspire évidemment
du titre du roman du grand écrivain Gabriel Garcia Marques dans lequel il y
décrivait la lente agonie, grotesque et
terrible à la fois, d’un dictateur latino-américain. Le régime algérien actuel n’a
plus rien à envier en termes de ridicule au régime du général Zacarias du célèbre romancier.
Comment en est-on
arrivé là ? Comment peut-on supporter cette image d’un président à ce point
malade qu’une seule photographie de lui, alors qu’il est censé être en pleine
possession de ses moyens puisque rencontrant pour d’importantes négociations un
premier ministre étranger, a fortiori représentant de premier plan de l’ex-puissance
coloniale, fasse à ce point scandale ? Comment les autorités et les
courtisans du régime peuvent-ils encore oser recourir sans mourir de honte et sans insulter l’intelligence de millions
de leurs propres concitoyens à l’inénarrable explication du « complot
étranger pour déstabiliser le pays » ? Et pourquoi donc se
précipiter chez cet « ennemi de l’étranger », si nuisible supposément
à la Nation, pour s’y faire opérer ou, plus scandaleux encore, pour des examens
qualifiés officiellement de « routine », donc, doit-on comprendre,
infaisables en Algérie plus d’un demi-siècle après la libération ?
Assez ! Tant d’Algériens, tant pendant la guerre
d’indépendance que durant les années quatre-vingt-dix, auraient-ils sacrifié
leur jeunesse, perdu leur liberté, auraient-ils été torturés ou tués uniquement
pour aboutir à cette caricature de république, dont se moque le monde
entier?
Alors que le pays n’a
jamais été autant en danger, que les
effroyables blessures de la décennie
dite noire sont loin d’être pansées, et que le terrorisme le plus abject de
Daech et d’El Qaeda le menace à l’intérieur et sur presque toutes ses frontières,
il est temps que cesse cette dangereuse situation d’Etat sans foi ni loi, ne
prenant même plus la peine de dissimuler qu’il se fiche comme de sa première
chemise du respect minimal dû au peuple et aux institutions. L’homme diminué
qui « occupe » actuellement le
fauteuil de président mérite, à l’instar de n’importe quel malade, toute notre compassion ; la
fonction présidentielle est, par contre, une institution qui ne supporte
aucune faiblesse et celui qui la représente doit être, au minimum, en
possession de l’entièreté de ses facultés, tant physiques que mentales. Il
n’est pas besoin de rappeler que la constitution algérienne, dans toutes ses versions,
même les plus malmenées, le précise explicitement. Il est vrai qu’il n’y a pas
grand-chose à attendre d’un Conseil
constitutionnel ou d’un parlement algériens qui n’ont jamais donné l’exemple du
courage civique.
Il ne faudrait pas
ajouter aux tares habituelles du système de gouvernement algérien la bouffonnerie,
insupportable de mépris envers les citoyens, du théâtre d’ombres qui se joue actuellement
à la tête de ce pays entre des marionnettistes plus ou moins cachés et des
acteurs prétendants-prédateurs à la magistrature suprême, théâtre sordide d’avidité
et de cupidité où d’aucuns se prennent à injurier
leurs concurrents présumés au moyen d’un vocabulaire digne des voyous politiques qu’ils sont en réalité. Quand
on considère, en outre, les nombreuses affaires de corruption et de scandales
financiers, tels les « Panama
papers », qui empuantissent l’atmosphère politique et sociale de notre
pays, on ne peut s’empêcher de penser au motif sinistre des vautours, présent
au début et à la fin du roman de Marquez.
Menacée de toutes parts, mal gouvernée par un
pouvoir cynique n’hésitant pas à tordre à
son profit les institutions judiciaires, constitutionnelles et même
religieuses, l’Algérie n’a pas les moyens de se payer, en plus, le luxe d’une
longue, cruelle et indigne fin de règne
à la Franco ou à la Bourguiba. Oui, répétons-le, il est vraiment
urgent que se termine cette nouvelle provocation envers le peuple
algérien !
Anouar
Benmalek, écrivain
(membre fondateur du Comité
algérien contre la torture, membre du comité d’édition du « Cahier Noir
d’Octobre »)
Inscription à :
Commentaires (Atom)